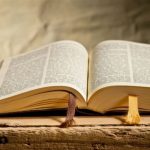Cette formule célèbre, titre d’un film de François Truffaut (1983) et d’une émission télévisée nous sert à introduire ce que les chrétiens appellent toujours « Le jour du Seigneur. »
Avec le journal télévisé, c’est la plus ancienne émission de télé. L’émission, à ses débuts, en 1950, était tournée en studio et, à partir de 1970, la messe est diffusée dans les édifices religieux ou en plein air. Le Village Saint-Joseph a été deux fois la scène de tournage.
Pendant le confinement, l’émission s’est déroulée à nouveau en studio et a connu une belle audience du fait de l’absence de célébrations publiques.
Charles Aznavour, dans les années cinquante, chantait « Je hais les dimanches. » Ce texte pessimiste fit polémique dans la mesure où le dimanche était synonyme de repos. La notion de travail salarié ayant beaucoup évolué, certaines personnes travaillent ce jour-là et la notion de week-end s’est substituée au terme « repos dominical. «
Serge Kerrien, diacre permanent, fait remarquer : « L’époque n’est guère favorable au dimanche. Les loisirs l’ont envahi et les activités commerciales tendent à en faire un jour comme les autres. Pourtant, Vatican II a insisté sur l’importance, pour les chrétiens, du dimanche comme célébration du mystère pascal. Nos communautés chrétiennes perdraient beaucoup à se priver de l’eucharistie et à ne pas renouveler leur manière de vivre le dimanche. »
Dans sa lettre apostolique, Dies domini (le jour du Seigneur), saint Jean-Paul II écrit : « Le dimanche appartient à l’identité chrétienne : il ne doit être ni banalisé, ni trahi. Loin de constituer une évasion, le dimanche chrétien implique que le fidèle s’engage à la solidarité, faisant du dimanche une école de charité, de justice et de paix. » … « Quant à la fraternité chrétienne, elle se marque d’abord par le fait de se réunir. L’assemblée dominicale est un lieu d’unité qui engage à l’amour mutuel. »
Dimanche, le jour du soleil
Le dieu du soleil fait l’unanimité dans toutes les cultures. Importé par les légionnaires, une dévotion au « soleil invaincu » s’impose au troisième siècle. Le 25 décembre, jour du solstice d’hiver, une fête officielle est donnée en son honneur. Adepte jusque-là de ce culte, l’empereur Constantin (280 – 337) se convertit au christianisme. Aussi, il décrète, au quatrième siècle, que le jour du soleil est désormais un jour de repos légal dans l’empire. Avec le christianisme, la dénomination va évoluer peu à peu. Il devient le jour évoquant la résurrection du Christ (dies Dominicus), futur dimanche, et le 25 décembre va devenir le jour de sa nativité.
L’éloge du repos
Désormais l’hyperactivisme touche autant le travail que les moments libres, l’adage anglo-saxon « time is money » s’étant imposé. L’homme moderne ne prend plus le temps de s’interroger sur lui-même et le monde.
Le dimanche est le premier jour de la semaine, celui où, nous raconte la Bible, Dieu s’est reposé après avoir créé le monde. L’origine du repos dominical est liée au décalogue « Tu sanctifieras le jour du Seigneur. »
La forme la plus élémentaire du repos est le sommeil. Relisons à ce propos l’hommage au sommeil que Charles Péguy prête à Dieu : « On me dit qu’il y a des hommes qui travaillent bien et qui dorment mal. Quel manque de confiance en Moi ! Le sommeil est ma plus belle création. Moi-même je me suis reposé le septième jour. Des hommes n’ont pas le courage de ne rien faire, de se détendre, de se reposer, de dormir. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. »
Par ailleurs le repos est un don de Jésus, comme dans l’Évangile de Matthieu où le Christ lance son appel : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. » (Mt 11 -28-30)
Tout éloge du repos débute par une incitation à la lenteur. « Hâtez-vous lentement » comme le dit la sagesse populaire reprenant la morale de la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Prendre du temps pour vivre, pour aimer, être plus proche des personnes, de la nature.
Laissons le mot de la fin à Frédéric Lenoir : « Notre monde est pris dans cette frénésie de l’activisme, de l’accumulation des richesses. L’essentiel du bonheur de l’homme ne relève pas de ses possessions mais de la paix de l’âme. »