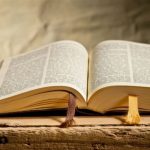Après avoir évoqué précédemment dimanche, mardi et mercredi, passons en revue, les autres jours de la semaine.
Lundi
« Le lundi au soleil, c’est une chose qu’on n’aura jamais », chantait Claude François, déplorant la reprise du travail hebdomadaire.
Si les statisticiens considèrent qu’on passe un septième de sa vie un lundi, d’autres font remarquer malicieusement que chaque dimanche est suivi par un lundi quoi qu’on y fasse. Cependant, n’oublions pas que, pour certains, le lundi est jour de congé.
Si, dans l’antiquité romaine, le dimanche est le jour du soleil, le lundi est celui de sa sœur, la lune (Lunae dies). Soleil et lune symbolisent ensemble le cycle des saisons.
Pour les chrétiens, retenons deux jours fériés : les lundis de Pâques et de la Pentecôte.
On pourrait définir le lundi de Pâques comme le rescapé d’une ancienne tradition chrétienne, l’octave de Pâques institué par l’empereur Constantin. Il s’agissait, à l’époque, d’imposer huit jours fériés consécutifs, ponctués de messes quotidiennes, pour célébrer la Résurrection du Christ. Une semaine très solennelle qui rassemblait tout le monde dans la prière et permettait à certains, au Moyen Âge, de partir en pèlerinage à Rome.
Cette tradition prit fin en 1802, avec le concordat napoléonien qui reprit l’organisation des pratiques de l’Église de France sous sa tutelle. Il décida de revoir, à la baisse, le nombre de jours fériés (50 jours à l’époque).
Quant au lundi de la Pentecôte, il reste un jour férié pouvant être travaillé (journée de la solidarité).
Ce jour-là se déroulent aussi des pardons, comme celui de Saint-Éloi en Paule. C’est également un moment privilégié pour les pèlerinages locaux ou nationaux.
Jeudi
Le Jovis dies, jour romain du dieu Jupiter, se transforme au fil des siècles en notre jeudi national. En 1882, ce jour devient jour de repos pour les enfants qui peuvent participer au catéchisme hebdomadaire. En 1972, la journée libérée chaque semaine passe au mercredi.
Dans la tradition catholique, le jeudi est marqué par des dates importantes.
Le Jeudi saint :
Jésus prend son dernier repas avec les douze apôtres dans la salle dite du Cénacle. En prenant le pain et le vin, le Christ rend grâce et offre son corps et son sang pour le salut des hommes.
Au cours de ce repas, Jésus, prenant la tenue de serviteur, va laver les pieds de ses disciples. Pendant la messe de ce jour, on répète ce geste solennel.
Après avoir sonné à toute volée, les cloches se taisent pour retenir leur souffle, en mémoire de la Cène, le dernier repas de Jésus avant sa mort, jusqu’au samedi soir pour la veillée pascale.
Le jeudi de l’Ascension :
Pour le commun des mortels et les scolaires, c’est l’occasion de « faire le pont ».
Célébrée quarante jours après Pâques, c’est un jour férié. Pour les chrétiens, catholiques, protestants et orthodoxes, elle célèbre la montée de Jésus vers Dieu, son père. Mort et ressuscité, il quitte ses disciples tout en continuant d’être présent auprès d’eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer la force de l’Esprit-Saint.
Vendredi
Vénus, reine de beauté a aussi son jour le Veneris dies, à l’origine de notre vendredi.
Depuis le Vendredi saint, jour de la mort du Christ sur la croix, la tradition populaire y a vu un jour de mauvais augure. Surtout si, comme les disciples de Jésus, on est treize à table.
Les chrétiens consacrent ce jour-là à la pénitence et à la prière, en mémoire de la Passion du Christ. Ce jour du Vendredi saint reste férié en Alsace et en Moselle.
Pour les juifs, le vendredi est le jour de préparation du shabbat, fête qui commence le soir.
Samedi
Les Romains parlaient de ce jour comme celui dédié à Saturne (dies Saturnii).
Mais c’est l’appel au repos biblique qui va lui donner finalement son nom. Le sabbat va devenir notre samedi.
Dans la tradition chrétienne, c’est au terme de cette journée, appelé Samedi saint, que le Christ ressuscite.
À l’origine, la veillée pascale se déroulait dans la nuit du samedi au dimanche. Au 8ème siècle elle fut avancée au samedi soir, puis au samedi matin. Restaurée par Pie XII, en 1951, elle doit être fixée de telle façon qu’elle se déroule entièrement de nuit, entre le coucher du soleil, le samedi soir, et le lever du soleil, le dimanche matin.
Dans la tradition hébraïque, le shabbat commémore le repos de Dieu, au terme des six jours de la création.
Après l’exil à Babylone (6ème siècle avant Jésus-Christ), la pratique hebdomadaire du shabbat devient un pilier de l’identité juive. Les autres jours de la semaine sont désignés par un numéro, le dimanche étant le premier jour. C’est aussi ce jour-là que se réunissent les premiers chrétiens pour commémorer la résurrection du Christ.
La journée juive débute au coucher du soleil, comme le souligne la Genèse : « Il y eut un soir, il y eut un matin. »
Le shabbat dure du vendredi soir au samedi soir. Lorsqu’on dit que Jésus est ressuscité le troisième jour, on compte donc le vendredi, comme le premier jour, le samedi jusqu’au coucher du soleil, comme le deuxième et le troisième jour, celui de Pâques, démarre le samedi après le shabbat, c’est-à-dire après le coucher du soleil.
Ouf, la semaine se termine, le dimanche revient et le cycle de la vie continue inexorablement !